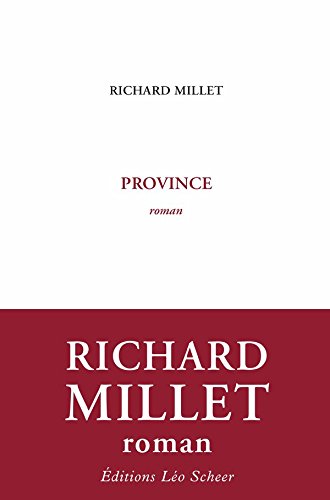Écrire sur la province – écrire Province – c’est se mesurer au temps, donner à voir et à sentir sa pâte. « La province, c’est le temps sensible et triomphant. » Grâce à la magnificence d’un style envoûtant, qui retrouve la magie originelle de la vive voix lorsqu’elle se conjugue au plaisir du récit, c’est l’entier de la langue que Richard Millet nous donne à entendre, et l’expérience même du temps humain qu’il nous fait partager.
Dans ce quatorzième roman, il nous transporte à Uxeilles, une petite ville du Limousin où « les valeurs constitutives de l’ancien monde sont encore très sensibles ». Entourée de grands bois, elle s’étage sur trois niveaux et compte deux camps : les « Océaniques » ouverts aux influences atlantiques, et les « Lépantistes » ainsi nommés parce qu’ils révèrent « la victoire de la chrétienté sur les Ottomans ». Une ville de cette province profonde, « si différente de tout autre lieu par son goût du secret, ou plus exactement le goût de se taire ». Et voici qu’une nuit de janvier, arrive un homme qui est de retour à Uxeilles après avoir fait carrière à Paris. Mais qui est cet homme qui semble avoir plusieurs noms ? Et pourquoi revient-il ? Pour une femme ? Pour s’occuper de son père ? Pour écrire le grand roman d’Uxeilles ? Pour « baiser le plus de femmes possible » ? Un retour dont on attend qu’il libère de l’ennui « qui nous habite, nous fait tendre l’oreille à tout, depuis le bruit de nos ventres jusqu’au lent déchirement des nuages dans le ciel », dit la voix féminine d’un témoin privilégié qui, par souci de ne pas se nommer, délègue le récit à la voix collective d’un « nous », d’une sorte de chœur d’où se détachent, quand il le faut, une figure et une voix qui s’individualise.
Ce concert de voix savamment distribuées nous fait entendre le bruire de ce qui se dit, se sait, se devine ou s’ignore. Chaque fait et geste du « revenant » est inlassablement commenté, soumis à l’exégèse publique, ce qui, dit la voix collective, « nous contraignait à sortir de nous-mêmes comme des renards enfumés. Il nous forçait à parler, à prendre parti, à regarder au-delà du cercle de nos jours et de nos prétentions ».
Ce retour, qui est pour Pierre Mambre – car tel est son vrai nom – l’occasion d’une descente au fond de soi, dévoile aussi ce que devrait être la vraie littérature : « aller au-delà du rideau et témoigner de ce qu’on voit ». Dire la vérité du monde, de ce qui est, car pour être à l’écart de tout, la province n’en connaît pas moins les problèmes de la France contemporaine. Elle a ses réfugiés, ses jeunes qui veulent partir pour la Syrie ou ceux qui rêvent « de s’ouvrir au grand vent du néant », qui plutôt que vouloir être « Rimbaud, Guevara ou Aung San Suu Kyi, punks ou djihadistes », désirent n’être rien et ne vouloir savoir que « ce que c’est que faire le mal pour le plaisir ». Mais derrière ces faits et leurs conséquences, ce qui s’entend, c’est l’immémoriale récitation des vies humaines – veuvages, amours, expiations, folies – sur fond de fatalisme, de monde en train de finir et de mélancolie.
Face à cet état de fait, l’enracinement dans la langue et le littéraire – qui n’est pas le littéral, faut-il le rappeler – devient un refuge et une réponse. Mambre est cet homme qui ne s’en laisse pas compter par l’esprit du temps, ne croit plus qu’en la langue, « la grammaire étant l’ultime divinité de ceux qui se sont résolus au crépuscule, de la même façon que vouloir baiser le plus de femmes possible était un acte littéraire ». D’où le constat de la vox populi : « Il nous avait déçus. Il n’était pas des nôtres. »
Richard Blin
Province, de Richard Millet
Léo Scheer, 336 pages, 19 €
Domaine français À la lisière de l’ombre
octobre 2016 | Le Matricule des Anges n°177
| par
Richard Blin
Renouant avec le genre romanesque, Richard Millet trouve un nouveau souffle pour témoigner des mœurs et des tourments de la province. Un roman aussi balzacien que désenchanté.
Un livre
À la lisière de l’ombre
Par
Richard Blin
Le Matricule des Anges n°177
, octobre 2016.