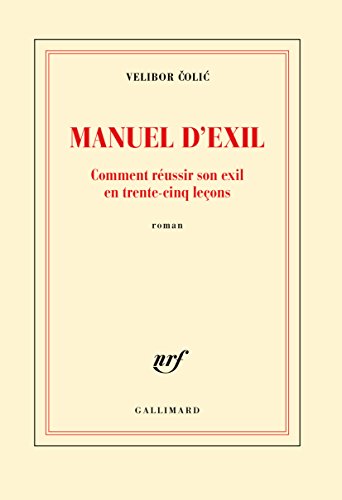Velibor Colic, les morsures de l'exil
C’est le récit fragmenté d’une errance perpétuelle. Celle d’un homme que l’Histoire a jeté aux vents mauvais. Jeté hors de sa terre, jeté hors de son temps, conduit hors de sa langue natale. C’est aussi le récit, peut-être, d’une renaissance quand l’écrivain part vers l’Est à la rencontre d’autres fétus humains aux dépens desquels l’Histoire a ricané.
On débarque à Rennes avec Velibor Čolić, puisque c’est lui, ce « je » qui, se dévoilant, décrypte aussi ce pays qui est le nôtre. Arrivée douloureuse parmi les demandeurs d’asile du foyer : « La misère du monde s’est donné rendez-vous à Rennes en cette fin d’été 1992. (…) des hommes perdus depuis longtemps, peut-être depuis toujours, entre les diverses administrations et les frontières, entre le vrai monde et ce sous-monde des citoyens de seconde classe, sans papiers, sans visage et sans espoir. » (p.23) Un monde où manger nécessite une stratégie, où le suicide devient une rêverie. À la porte duquel viennent frapper les souvenirs de la guerre qui brûle la terre des Slaves du sud. Ce sont de longues semaines durant lesquelles l’écrivain se découvre analphabète, le gouailleur muet. Pas de pathos pourtant dans ces pages où chaque texte est une pièce de mosaïque, dessinée au plus près d’une condition humaine cabossée. L’élégance du désespoir insuffle à Velibor Čolić l’art de la chute, drôle souvent, comme s’il fallait en rire plutôt que d’en pleurer. Ou lyrique d’autres fois, tel l’alcoolique qui tutoie les étoiles. Comme si l’écriture n’avait d’autre fonction que celle de réécrire, en mode meilleur, la chose vécue. L’écriture est aussi ce qui sauve du suicide : « J’écris tout le temps, partout. Je papillonne au moins dix fois par heure entre mes récits. » Deux romans tiennent l’écrivain à sa table, ainsi qu’un essai sur la guerre et un long poème. Le sang coule aussi dans ses stylos.
Tintin et Albert Camus lui enseignent la langue d’adoption : « Il me faut apprendre le plus rapidement possible le français. Ainsi ma douleur restera à jamais dans ma langue maternelle. » Et la littérature le sauve quand paraît, chez Galilée d’abord, au Serpent à plumes aussitôt après le magnifique Les Bosniaques qu’il écrit à Strasbourg. La guerre est là qui, à défaut d’intéresser les Français, dessine un champ d’affrontement médiatique aux intellectuels français. Pour faire couleur locale, Velibor Čolić est invité avec quelques-uns de nos beaux esprits maquillés pour les plateaux télé. On devine lesquels et cela donne des pages aiguisées au vitriol. C’est que l’écrivain croato-franco-bosnien excelle dans le croquis vif, le trait tiré sur le motif. Portraits et saynètes sont saisis comme noix de beurre sur plancha : mais c’est le lecteur qui grésille de plaisir. L’humanité résiste à l’air du temps autant qu’aux méfaits de l’Histoire.
Tant qu’on meurt à Sarajevo, l’écrivain bosniaque intéresse les radios. Ironique et lucide, Velibor Čolić préfère porter son affection à ses semblables, les perdants...