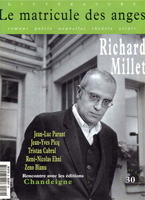Du train, je vois les brumes lentement sur le fleuve descendre à la mer. Les eaux légères des nuages glissent dans la gorge noire du paysage. Les têtes penchées sur des livres d’étude sont immobiles. Et les cheveux font des taches claires et sombres dans le wagon. Dans un tunnel, les vitres deviennent des miroirs de mercure et dans l’une d’elles, je vois le visage d’une femme endormie qui se mélange au mien. Régulièrement brûlé par les feux de sécurité. J’écoute une Africaine qui parle de son amant qu’elle a rencontré dans une soirée, il y a maintenant trois semaines et qu’elle a volé à une amie qu’elle aime bien mais avec qui l’amant s’endormait. Personne peut imaginer à quel point il aime ça. Elle, cela ne la dérange pas. De jeunes Américains se dirigent à hautes voix vers le wagon restaurant et reviennent à hautes voix, des boissons pétillantes et glacées dans les mains. Ils marchent dans les deux sens, dans le paysage absent. Je m’endors dans le visage de la femme endormie que je ne vois pas. Nos reflets j’imagine, sont des rêves d’arbres et de prairies.
Dans la gare, les frôlements sont précis comme ceux des carpes koïs dans un bassin d’eau claire. Les verrières laissent tomber du ciel le jour et son soleil, mélangés de poutres métalliques. Un garçon de café, la moustache tranchante sur une face lunaire et amicale, (la lune est amicale qui ressemble à l’humain lorsque pleine elle inonde nos chambres), me refuse une bière pression. L’ordinateur central est en panne et toutes les brasseries de la ville attendent que le robinet électronique ouvre les vannes. Je sors de la gare pour marcher le long des quais.
En avance sur mon rendez-vous, aux Beaux-Arts, je visite une exposition de travaux de fin d’année. Une surface blanche de six mètres sur six ouvre l’œil à son maximum. Un bloc se détache au centre. C’est un haut-parleur qui diffuse les bruits enregistrés de la fermeture du jardin du Luxembourg. Des cris d’enfants dans le grand escalier des Beaux-Arts. Des voix et des aboiements. Des ronflements de voitures et des klaxons, des appels. Des chuchotements. Sur la toile blanche aucune image ne se dépose. J’attends mon rendez-vous et la fermeture du jardin sur la toile blanche.
J’entre dans une pièce sombre. Sur un écran de télé, une femme est assise, immobile dans un canapé. Elle ne bouge pas. Ce n’est pas une photographie, mais elle ne bouge pas. Dans un vase, une longue tige penche sous le poids d’un tournesol géant. Il ne bouge pas. Sur le mur opposé à celui de la télévision, un écran vidéo sur lequel passe un film. La même femme danse sur un trottoir. La scène est très faiblement éclairée. Une musique répétitive illustre les gestes de cette femme qui danse précautionneusement. Son nom est Anna Dahl. Derrière moi un lit une place avec une couverture imprimée. Les motifs eux-mêmes répétés, sont des hommes stylisés comme des fils de fer tordus, dont la tête est une feuille de frêne. Au-dessus du lit, deux photographies. L’une d’un bras et l’autre d’une jambe avec un peu de hanche, et comme en tatouages les petits bonhommes collés dessus. Deux fois, trois fois je regarde danser Anna Dahl. Puis, c’est l’heure de mon rendez-vous.
Dans la soirée, je me retrouve seul à Belleville, j’attends encore. Des Chinoises accroupies parlent aussi fort que les Américains du train, contre les grilles d’un jardin qui sent l’urine et la merde. Les Chinoises s’engueulent ou peut-être se racontent-elles de douces histoires en hurlant pour couvrir le bruit de la ville ? Plus loin des Arabes se saoulent de bière et se racontent des histoires ou peut-être s’engueulent-ils ? Les deux groupes ne se regardent pas. Un prêcheur s’installe près de moi et dans le va-et-vient des hommes pressés lance le cri fatidique de la solitude urbaine. Il attrape deux-trois personnes, qui certainement ont quelques minutes à lui consacrer, par ennui, ironie, provocation ou intérêt. À vingt mètres de là, un Latino Américain vend un bouquet de fleurs à un automobiliste qui bloque la circulation. Il pose le bouquet sur le siège avant, paye et démarre, l’air préoccupé. Le fleuriste arrange ce qui lui reste, c’est-à-dire quatre bouquets sur un carton renversé qu’il cale sur son ventre. De l’autre côté de la rue, des policiers verbalisent une épicerie clandestine. Le fleuriste jette ses fleurs dans le carton et se précipite dans le métro. Le prêcheur plie son matériel après avoir vendu un compact disque du paradis. L’homme regarde courir le prêcheur dans la foule en ouvrant le boîtier. Il cherche le disque, qu’il ne trouve pas, et son visage retourne à la vitesse. Je marche dans cette rue qui plonge dans un fouillis d’échoppes et de ruelles. Dans le caniveau d’un supermarché chinois, des rats morts, le ventre plein, flottent à moitié dans la sueur des jours passés. Un grand noir se tient le dos calé contre un luminaire. Son visage est énorme et déformé. Ses pieds dans des sacs de plastique bleu sont nus et sans doigts. Ce sont des morceaux de charbon mouillé de maladie. Il tend la main.
Anna Dahl m’accompagne et ce soir je mangerai dans un restaurant grec. Le restaurateur me dit qu’il faut que l’on se mélange plus encore et la guerre sera impossible comme ça. Des femmes, des frères et des sœurs partout et la guerre ne pourra plus avoir lieu. À table les artistes peintres parlent de peinture, d’espoir et de la vie qui est plus ou moins difficile à vivre.
Dans la rue, je regarde les jongleurs, les sculptures vivantes et les touristes qui défilent. Chacun porte en lui un regard, son parcours, une cité. Et tous, nous cheminons dans cette transparence. Nous traversons certaines cloisons aux portes étroites, mais c’est la transparence qui nous entretient.
Je reprends le train et m’endors dans le reflet d’un autre visage et notre sommeil s’étale sur les murs d’une cité invisible. Le train quitte les derniers bâtiments. La nature reprend le dessus et j’entends distinctement sur un trottoir rêvé qui ne mène nulle part, les pas de danse d’Anna Dahl et cette musique maintenant qui m’accompagne.
Nouvelles Je ne connais pas Annah Dahl, nouvelle de Clair Bastard
Né en 1955, Joël Clair Bastard vit dans une ferme isolée dans le mont Jura. Il y élève des "bestioles" : ânes, chevaux, chiens et y écrit beaucoup : poésie (prix Voronca 1992 pour Mémorandum de porcelaine - Éd Brémond), théâtre, un oratorio, des chansons (sur des musiques de Monk, chantées par Christine Python), des nouvelles publiées en revues (Passage d’encres N°11). Il va publier Le Chant de la betterave, chez Éric Coisel. Ancien ouvrier bijoutier, il a dirigé une galerie d’art à Ferney Voltaire.Parmi les derniers livres lus : Raymond Carver Tais-toi je t’en prie (Stock), la poésie de William Cliff ou Comme un bruit de source de Xavier Bordes (Gallimard).