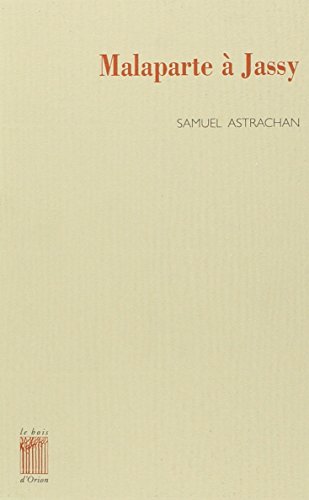Si un hôtel est le lieu où l’on passe, il est donc une belle métaphore pour parler de la vie. Pour Samuel Astrachan, né à New York en 1934, issu d’une famille juive de Russie, il est fort à parier que l’hôtel dont il est question est aussi une véritable boîte à souvenirs.
En 1947, l’Hôtel Sevilla est tenu par et pour des Juifs, originaires de la même région, là-bas, en Russie. On imagine l’ambiance familiale qui y règne. D’ailleurs, pour faire le portrait des habitants du lieu, Samuel Astrachan aime utiliser le pluriel : « Comme la plupart des hommes à l’hôtel, les Cohen travaillaient tous les jours en ville. Ils s’en allaient tôt le matin dans leur Buick ou leur Oldsmobile et s’en retournaient, douze heures plus tard, leurs cravates desserrées ou carrément enlevées, leurs chemises blanches à manches courtes collées contre leur dos. » Les Cohen sont quatre et on eût aimé qu’ils fussent trois, pour donner une symétrie américaine aux trois sœurs de Tchekhov. Car Samuel Astrachan ne nous plonge pas seulement au cœur de cette famille où Eshka, la mère qui lit les cartes semble comme une reine.Il distille, au fil des pages, une nostalgie et une poésie du quotidien qui touchent et font penser au maître russe évoqué dans le livre. Imposant lentement le rythme de ses phrases, l’auteur explore des thèmes importants (la condition de la femme, l’exil, la création littéraire, la mort) sans jamais appuyer le trait, sans jamais sortir de sa partition : la musique d’un piano qu’on entendrait assourdie s’échapper d’une fenêtre.
C’est un roman tendre et bouleversant au devant duquel jamais ne s’affiche l’écriture.Tout en retenue, l’auteur semble ne rien écrire vraiment, ne rien inventer.Il est comme le médiateur, le canal par lequel se communique à nous une culture. Nous ne savons pas quelle part autobiographique il pourrait y avoir dans ce livre, mais qu’importe.La qualité reste la même : un mélange d’infinie tendresse, de sincérité et de modestie.
Eshka a perdu son mari un an auparavant, elle essaie de protéger ses enfants, surtout Max qui veut être écrivain et pour connaître le monde s’engage sur le navire de ses oncles : « À Anvers, il vit des ruines et des décombres causés par la guerre.Il alla dans le centre ville avec Big Sam et Big Joe, l’un gros, l’autre grand, et ils mangèrent des steaks, burent de la bière, et ensuite ils allèrent rue « Skippy » où sont les filles. » Max reviendra à New York où il rencontrera le nouvel amant, le dernier amour de sa mère, Élie Kaminsky, romancier d’origine polonaise qui écrit une langue morte pour les néo-Américains : le Yiddish. L’écrivain tentera d’aider le jeune garçon à trouver la voie de la littérature, comme s’il lui passait le relais, pour l’amour de sa mère.Celle-ci, se découvre gravement malade et marche vers sa mort avec une dignité de femme forte. Elle contemple le monde autour d’elle, elle sait par les cartes qui lui disent l’avenir, les drames qui toucheront ses enfants. Ne lui importe plus alors qu’à trouver malgré l’effroi, la paix rédemptrice qui la conduira au trépas.
L’Hôtel Sevilla va se vider peu à peu, et la génération des pionniers qui l’avait investi, arrivée à un âge où l’on n’entreprend plus rien, ne laissera finalement pas grand-chose aux enfants que l’Amérique a adoptés.
Pas grand-chose si ce n’est peut-être la littérature. Et il n’est finalement pas besoin qu’elle soit écrite en yiddish pour nous faire entendre les accents d’Eshka et des Cohen.
Hôtel Sevilla
Rockaway Beach, 1947
Samuel Astrachan
Traduit de l’américain par
Claude Jeanneau
Le Bois d’Orion
182 pages, 115 FF
Domaine étranger Hôtel du nouveau monde
juin 1996 | Le Matricule des Anges n°16
| par
Thierry Guichard
L’Américain Samuel Astrachan retrouve ses origines avec son deuxième roman traduit en français. L’histoire à la Tchekhov d’une famille juive.
Un livre
Hôtel du nouveau monde
Par
Thierry Guichard
Le Matricule des Anges n°16
, juin 1996.