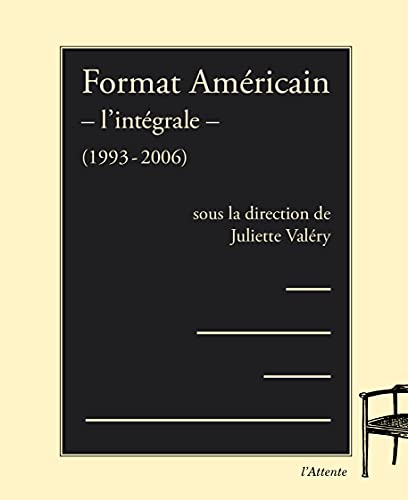L=A=N=G=U=A=G=E, le livre
L’anthologie L=A=N=G=U=A=G=E, Le livre, ne nous y trompons pas, n’est pas un étendard. Elle n’a pas pour fonction de réunir les textes d’une école, d’a posteriori de la dénommer telle. L’introduction au volume, par deux poètes phares du mouvement, Bruce Andrews et Charles Bernstein, est claire : « L=A=N=G=U=A=G=E était d’abord une revue d’information et de commentaire bi-hebdomadaire [12 numéros entre 1978 et 81], forum de discussions et d’échanges. Nous avons toujours mis l’accent sur un spectre d’écritures ayant pour principal objet d’attention le langage et les différentes manières de faire sens, et ne considérant ni le langage, ni la grammaire, ni le processus, ni la forme, ni la syntaxe, ni le programme, ni le sujet, comme allant de soi. » La méthode Opening of the field, pour reprendre le titre d’un livre phare de l’objectiviste américain Robert Duncan, opéra d’emblée la diversité des approches de l’objet « langage » comme horizon commun. Les modes et les régimes d’écriture, tantôt proches de l’énoncé, poétique ou philosophique, voire linguistique, tantôt spéculatifs et directement réflexifs, n’y sont pas hiérarchisés, bien au contraire, ils s’appuient chacun sur la pratique de la poésie et du poème de chacun. La fin du poème, s’il y en a une, la réflexion à laquelle sa pratique conduit, relèvent d’abord de ce qu’il est expérimenté comme recherche d’une forme. Il est dit laconiquement à un endroit du livre que seule la forme crée du contenu, on pourrait ajouter qu’aucun contenu ne survit à l’emprise du cliché s’il n’est porté par une forme spécifique, ce que Alan Davies appelle magnifiquement dans ses propositions « la structure » : « la structure, écrit-il d’abord, est combinaison physique », pour, immédiatement préciser que son économie « maintient le matériau, l’acceptant dans la structure », car, est-il déduit, « la structure préfigure les matériaux », par « nécessité » ils doivent être à leur place, comme des mots le sont dans un poème réussi.
Divisé en trois grandes parties (« 1. Poétique et langage », « 2. Écriture et politique », « 3. Lectures »), l’ouvrage est une mine à ciel ouvert de matériaux effervescents, dont les formes varient selon les poétiques et les contextes (conférences, articles, manifestes, etc.) Bernadette Mayer, par exemple, associée à l’École de New York et à ce que l’on a appelé la Poetry Project, à qui l’on doit le fameux Memory (1975), journal quotidien révolutionnaire dont le résultat est un travail conceptuel qui étudie la nature de la mémoire, ses surfaces, ses textures et ses matériaux au travers plus de 1 100 photographies, deux cents pages de texte et six heures d’enregistrement audio, livre ici des « Propositions » réjouissantes : elles pourraient être le work in progress d’amorces multiples d’écritures et d’ateliers. Sous forme de contraintes, elles requièrent la volonté de faire, de noter, de soumettre le texte à ses grammaires internes. Les verbes ouvrent des actes (choisissez, éliminez,...