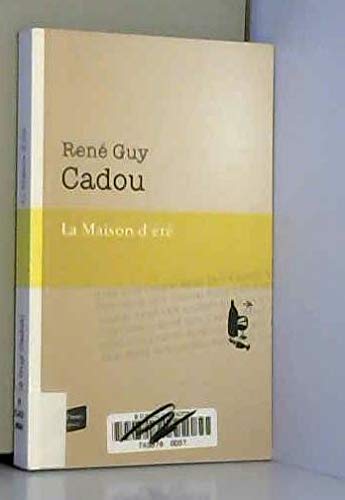Lorsque ce roman s’ouvre, nous plongeons dans le Paris peu hospitalier de l’entre-deux-guerres, avec ses « flaques d’huile, lourdes comme des flaques d’âmes ». Gilles, à la fois narrateur, protagoniste et possible alter ego de l’auteur, y traîne sa pauvreté et sa difficulté à vivre. Quelques pages plus loin, le voici à la campagne, pour une escapade qui a les allures d’une délivrance. Une campagne dans laquelle il n’est pas interdit de deviner la Grande Brière, dont Cadou était originaire, à la fois généreuse et nourricière, pleine d’une poésie qui vous réconcilie immédiatement avec la vie, avec ce soleil qui chaque matin « promène sa langue sur les chaumes » et « met sa bave de lumière partout ». Une campagne où il fait simplement bon vivre, et où l’on n’hésite pas, à la fin d’un repas toujours copieux, à déboucher une bouteille de liqueur de prunelle pour vous en servir un verre.
Mieux encore : il y retrouve Amélie, la bonne nourrice d’antan, qui l’accueille avec sa « grosse table en bois dur, vernie par les coudes » et qui lui offre le réconfort que la vie parisienne s’obstinait à lui refuser : « De sa douce main usée, Amélie me relève le menton et je vois dans ses yeux comme un grand ciel d’été plein de meules. »
Sur un coup de tête, Gilles loue ses services comme journalier chez un fermier du coin, un nommé Frangeul. Au programme : battage, arrachage des betteraves et des pommes de terre, puis vendanges. Et en prime : la découverte de l’hospitalité rurale, le plus souvent autour d’une table conviviale et rustique. C’est dans cette campagne que Gilles rencontre Bertine, en qui Frangeul voit « une belle garce », ce qui n’empêchera pas notre modeste héros de goûter sa joue, brûlante comme « une feuille de figuier quand elle a été chauffée par le lourd soleil de midi ». Et l’amour qu’il connaîtra brièvement auprès d’elle sera dit avec pudeur : « Alors ma main la chercha, en fit un bruissement d’étoffe, une longue plainte étouffée, ses seins coulaient entre mes doigts, s’en échappaient comme une poignée de grains, je la déshabillais. »
Sans que l’on sache très bien pourquoi (peut-être honteux d’avoir cédé à l’appel de la chair), Gilles s’enfuit, presque du jour au lendemain. De retour à Paris après son immersion dans la vie rude et authentique des travaux de la ferme, il retrouve « la faune des grandes cités ». Ses retrouvailles avec la capitale n’ont rien d’un conte de fées : il apprend que la chambre dans laquelle il séjournait (et où il a vécu des heures particulièrement douloureuses) est désormais occupée par une demoiselle. Mais dans les pages qui suivent les miracles romanesques s’enchaînent pour le tirer d’affaire : il est d’abord affecté au tri des lettres de la gare Saint-Lazare, ce qui lui permet de se construire « un bonheur facile, à la petite semaine », puis il rencontre Agna, la violoniste et locataire de son ancienne chambre. Dont il tombe rapidement amoureux, et qui lui fait obtenir un petit emploi au Ministère.
Quelque temps plus tard, avec une Agna enceinte jusqu’aux yeux, ils se rendent en pèlerinage dans la maison d’été (celle d’Amélie), où la belle parturiente leur donne bientôt un fils. Seules ombres au tableau dans cette fin idyllique (et pour le coup des ombres vraiment noires) : la mort d’Amélie, presque aussitôt suivie par celle de leur enfant.
Pas besoin de lire cent pages pour comprendre que La Maison d’été est le roman d’un poète. La poésie y est omniprésente : elle y transpire à chaque page, car elle est la respiration naturelle de Cadou (cf. Poésie la vie entière, chez Seghers, qui présente l’intégralité de son œuvre poétique). Ce paysage perçu d’un train en marche par exemple : « Des arbres couraient sans jamais nous rattraper. » Nous pouvons d’ailleurs reprendre ici la formule que Cadou appliquait lui-même au Grand Meaulnes d’Alain-Fournier : nous ne quitterons pas ce roman sans avoir ressenti « ce tremblement merveilleux du poète ». Et nous sommes bien plus requis par la beauté de ces fulgurances poétiques (souvent pleines de candeur : « Alors le soleil sortit de son œuf, jaune encore, un peu ébouriffé, embarrassé dans ses plumes ») que par l’intrigue, qui ne brille pas par sa complexité.
Au final, nous ressortons de ce roman (publié en 1955) comme nous le serions après avoir lu un conte : étourdis, incrédules, vaguement hypnotisés, et rendus à notre âme d’enfant, encore capable de s’émerveiller devant les beautés du monde et de mettre un peu de magie dans la vie quotidienne : « Le soleil est tout contre l’horizon comme une bête apeurée, il rejette la terre avec ses pattes de derrière, une terre rouge qui embrase le ciel. »
Didier Garcia
La Maison d’été, de René Guy Cadou
Le Castor Astral, 192 pages, 7 €
Intemporels Trois femmes
novembre 2019 | Le Matricule des Anges n°208
| par
Didier Garcia
Le poète René Guy Cadou (1920-1951) a écrit un seul roman : La Maison d’été, pour célébrer l’amour et la vie rurale – en poésie.
Un livre
Trois femmes
Par
Didier Garcia
Le Matricule des Anges n°208
, novembre 2019.