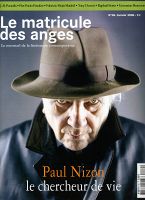Je ne connais que mon monde à moi, un monde qui s’élargit, s’amplifie », écrivait le peintre autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980) dans Ma vie, son autobiographie. Celui que l’on tient pour le peintre de la Sécession et pour l’un des pères de l’expressionnisme ne put se contenter de ses seuls pinceaux : il prit aussi la plume, tantôt comme poète, tantôt comme dramaturge, ou comme ici pour les fictions des Mirages du passé, recueil pour le moins déroutant, traduit en français en 1966.
Bien que Kokoschka ait prévenu son lecteur que « tous les personnages de ce livre sont entièrement imaginaires », c’est le peintre lui-même que l’on retrouve, non seulement dans les lieux qu’il a fréquentés, mais aussi dans sa vie artistique, comme dans le premier texte où il évoque Der Sturm, le périodique d’art expressionniste dont il fut l’un des fondateurs avec Herwarth Walden.
Très rapidement, on perd de vue cette figure centrale et les femmes qui gravitent autour d’elle (de la jeune fille ingénue qui aime sa tortue à la femme sculpteur capable d’incroyables violences et qui réalise des embryons d’argile), pour mieux rester au contact du texte. Kokoschka écrit « à bâtons rompus », et il faut une lecture particulièrement attentive pour ne pas décrocher (il invite d’ailleurs le lecteur à sauter certaines pages et lui assure qu’ils n’en resteront « pas moins bons amis pour autant »). La dernière des sept Lettres d’un voyageur dans un monde imaginaire (le plus long des textes réunis) illustre parfaitement la manière dont Kokoschka construit son récit. Partant de l’avers d’une pièce de monnaie phénicienne, il dérive bientôt vers le cheval en tant qu’animal mythologique, évoque successivement les sports hippiques, l’empire romain, les courses de chars, le citoyen anglais, le carnaval, avant de solliciter la patience du lecteur (cela vient à point nommé car cette mise en bouche dure quand même depuis sept pages) : « dans cette introduction un peu prolixe, j’ai trop développé l’idée du cheval sans cavalier », mais « l’histoire du démocrate moderne que sa bête a désarçonné a, au fond, peu de rapport avec le récit, et sert plutôt à découvrir jusqu’où l’on peut aller sans mettre l’endurance du lecteur à trop rude épreuve » (c’est un avis qui n’engage que l’auteur !). Fort de cette mise au point, il revient alors à sa pièce phénicienne, examine son revers (pour un peu on l’oubliait), puis le commerce phénicien, la mort dans les civilisations de l’Antiquité, et le texte, en suivant sa pente naturelle, ou son absence de pente, en arrive à Hérodote, « qui répandit le bruit que la teinture rouge se fabriquait avec le suc du murex ». Cette ineptie passée et stigmatisée, suivent encore quelques paragraphes sur les guerres puniques, et la première partie s’achève, après seulement treize pages. Au début de la deuxième, qui s’ouvre sur l’introduction du grison en Irlande par Napoléon Ier, on est franchement tenté de passer au texte suivant… Ce pourrait être du Laurence Sterne, tel qu’il se donne à lire dans Tristram Shandy, mais là où la digression est promue au rang de procédé romanesque elle est ici le fait de l’inconscient, qui suit son petit bonhomme de chemin au gré d’associations que lui seul doit pouvoir comprendre, et qui l’écartent aisément du fil du récit (quand il y en a un). Et ce serait du Sterne si les évocations n’étaient pas si sérieuses, même s’il arrive à Kokoschka de céder à l’humour, par accident dirait-on, comme lorsque le voyageur rencontre brutalement un ânon : « Quelques gouttes de lait pendaient à son museau aussi velouté au toucher qu’une fourrure de taupe ».
Ces Mirages du passé se situent toujours à la frontière du réel, dans un monde qui ne tient plus très bien sur ses jambes (dans un bus, alors qu’il fait escale à Chypre, le narrateur est pris pour Judas Iscariote, méprise qui le contraint à une fuite rocambolesque). La toute-puissance du rêve y est bien sûr pour beaucoup alors qu’elle se trouve sur le point d’accoucher, une jeune femme rêve de devenir une poupée.
Malgré ce refuge toujours possible dans le rêve (qui sait aussi se montrer inquiétant), reste une lourdeur, presque perceptible à chaque ligne. Quel que soit le lieu (l’Écosse, Chypre, la Tunisie, l’Irlande ou Berlin), les personnages paraissent affligés de la même difficulté à vivre et à se poser dans le réel. Une maladie sans nom qui s’explique pourtant facilement : « Désenchanté de tout ce en quoi j’avais jamais cru, écœuré par les ignobles événements de l’époque, j’en avais assez de vivre ».
Ceux qui ont lu les lettres de Paul Klee ou celles de Van Gogh le savent : on éprouve un plaisir singulier à découvrir un peintre loin des salles d’un musée (les lettres du jeune Klee à sa Lily Stumpf le montrent moins sous les traits d’un peintre que sous ceux d’un homme amoureux et ce retour à l’humain fait parfois du bien). Chez Kokoschka, pas moyen de sortir de l’œuvre picturale, célèbre pour ses portraits et l’ambiance dramatique de ses toiles : chez lui, écriture et peinture ne font qu’un.
Mirages du passé
Oskar Kokoschka
Traduit de l’allemand et de l’anglais
par Louise Servicen
Gallimard,
« L’Imaginaire »
262 pages, 7,62 €
Intemporels Kokoschka, l’étoile noire
janvier 2006 | Le Matricule des Anges n°69
| par
Didier Garcia
Cinq portraits de femmes, qui sont autant de prétextes pour éviter le réel et trouver refuge dans le rêve. Où le passé vit encore.
Un auteur
Un livre
Kokoschka, l’étoile noire
Par
Didier Garcia
Le Matricule des Anges n°69
, janvier 2006.