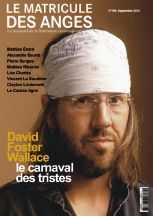Europe N°1033 (Claude Simon)

Né en 1913, Claude Simon est mort en 2005. Alors que d’aucuns s’étonnèrent lorsque le jury Nobel lui attribua, en 1985, un prix qu’ils n’étaient pas loin de juger élitiste, Simon, depuis, n’a cessé de susciter l’intérêt et l’admiration. Pour lui, nul purgatoire : la publication, sous la direction d’Alastair Duncan, des deux volumes de la Pléiade, en 2006 puis 2013, en témoigne. La revue Europe, à son tour, pour les dix ans de sa mort, explore avec sagacité les territoires de Simon. Se succèdent ici des études de portée générale – thématiques par exemple – et d’autres consacrées à des œuvres particulières.
Claro joue cartes sur table : peut-être serait-il nécessaire de lire Simon « comme relevant de – nécessitant – l’épreuve de la traduction ». En effet, « la prose de Claude Simon, parce qu’écrite dans une langue inédite qui a – peut-être – gardé du latin un sens inné de l’équilibre, une langue qui semble se nourrir dans son mouvement même de la dynamique du déchiffrement, nous oblige à vivre sa lecture comme on progressait naguère dans les pages de Tacite ou de Juvénal, subjugués ». C’est à une telle lecture attentive, comme mot à mot, qu’il se livre, tentant de rendre compte de cet « œil interne » (comme on parle d’oreille interne) qui rend possible les descriptions si magistrales qui forment souvent le cœur des récits de Simon. Patrick Longuet, lui aussi, s’intéresse à la phrase simonienne, au phrasé plus précisément, que l’écrivain élabore (par la reprise syntaxique, la ponctuation, la recherche lexicale) pour traduire les perceptions du corps, d’un « corps tramé de correspondances, celles établies à son insu par la mémoire, celles obtenues par le travail de l’image ». Images, ainsi, que ces paysages divers qu’analyse Jean-Yves Laurichesse : ferroviaires, automobiles ou aériens, ils correspondent à des modes de saisie différents du réel que le narrateur s’efforce d’appréhender. C’est bien, d’après Dominique Viart, à une sorte d’ « anthropologie élémentaire » que se livre Simon : pour réinventer un humanisme d’après Auschwitz, son œuvre est « élémentaire » « dans les deux sens du terme : elle se prend aux détails et s’attache aux éléments ». Ruines et murs couverts de graffiti, par exemple, sont des motifs que Simon photographe recherche – deux études s’intéressent ici à ce pan complémentaire de son travail. Certaines, enfin, nous incitent à la (re)lecture d’œuvres toujours susceptibles d’éclairages nouveaux : ainsi Christine Genin fait-elle l’hypothèse qu’Histoire (1967) serait tout entier « un roman autour d’un trou noir » : le suicide de Renée Clog, la première épouse de Simon, qui se donne la mort en 1944, après avoir appris la liaison de Simon avec une jeune modèle de 18 ans…
Thierry Cecille
Europe N°1033 (Claude Simon), 364 pages, 20 €