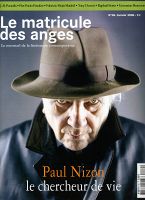Il y a quelques mois, je n’avais plus un rond. Je répondis à une offre d’emploi, catégorie vendanges. Je retournai plusieurs fois au château, afin de m’assurer d’y être employé. Le contrat offrait dix jours de travail minimum, 640 euros, une prime de « ténacité », mais pas les repas, ni l’hébergement. En attendant le jour fatidique où le goûteur, passant dans les allées, picorerait un Merlot et le trouverait à point, j’éprouvais du mal à contenir mon impatience, les yeux mi-clos dans le soleil qui cuisait encore. Il y avait trente ans que je n’avais pas ramassé le raisin. Je me rappelais que c’était physiquement éprouvant, un coupeur sur quatre n’achevait pas la période (d’où la prime). En étais-je encore capable ? Je me souvenais de ce que nous formions, mes camarades et moi, la lie de la terre. Des marginaux, des pauvres, des recalés, des allumés. Ma place était-elle restée chaude ?
Cinquante personnes battaient la semelle et soufflaient dans leurs doigts, ce matin-là, sous l’imposante futaie du parc du château. Après l’inscription, je collai au train du « Beau Serge ». Les Serge sont d’apparence flegmatique, celui-là devait son surnom à deux fentes bleu-vert dans un visage raviné, détentrices d’un secret autrefois dérobé aux femmes. Son aisance à parler avec les ouvriers permanents du domaine le désignait pour Médoquin. Quand nous fûmes à pied d’œuvre, les règes (rangées) montaient à l’assaut de la croupe (colline), des clochers de Gironde et d’un ciel bleu Ruysdael. J’étais « porteur ». J’acheminais, la hotte sur le dos, le contenu de quatre paniers de coupeurs jusqu’à un tapis mécanique, juché au-dessus d’un char, où des mains gantées de caoutchouc triaient le raisin, éliminaient les feuilles, « la diligence ». Ce premier jour pour prouver que nous n’étions pas les chenapans attendus ? Ou bien victimes, entre glaneurs, de l’euphorie que procure l’abondance ? nous nous livrâmes à une compétition au rendement. De jeunes porteurs couraient torse nu dans leurs règes, la charge sur le dos, comme des Tarahumaras. Si l’on attendait son tour au bas de l’échelle, en levant les yeux, le sourire de Claude, là-haut, qui se débarrassait de son fardeau, illustrait soudain une affiche de propagande soviétique. Les mains gantées de caoutchouc, jeunes et vieilles, nous suppliaient de freiner. Les coupeurs, ménageant leur souffle, ne parlaient plus mais grondaient. La plupart d’entre eux étaient ici pour gagner de quoi offrir des cadeaux à Noël, quelques un(e)s parce qu’il n’y avait plus rien à manger. Ajoutons deux ou trois couples d’étudiants intimidés. Des Gitans, des Marocains au rendez-vous de l’horloge annuelle où des tomates, des cerises, des pêches figurent d’autres heures. Je revins au soir, les épaules, les reins et les cuisses comme battus par quinze coups du knout que décrit Dostoïevski dans La maison des morts. Impossible de dormir.
Le lendemain, un mot d’ordre passa, chuchoté entre ceps et carassons (piquets) : « On ralentit ». D’un ciel gris, troué de façon sauvage, tombaient des voiles de pluie qu’absorbait une heure après un soleil assoiffé. Nous nous retrouvâmes bientôt désœuvrés, la hotte à terre et fumant, à jeter des regards inquiets en direction de la diligence. Sur sa passerelle, le propriétaire enchaînait les coups de téléphone sans se préoccuper de notre sort. À ses pieds, le contremaître jaillissait parfois, n’y tenant plus, pour nous replacer dans la vigne. Le message était clair : nous avions trop travaillé la veille, le contrat, qui assurait une durée, une somme minimales, n’avait pas prévu notre bonne volonté. Quelle attitude adopter ? Je résolus de la calquer comme d’habitude sur celle de Serge, qui coupait à son rythme et le monde pouvait bien s’écrouler. Il fumait, croyais-je, des Winston. Je lui en demandai une, qu’il me tendit, gêné. Le paquet cachait des confectionnées à la machine et à l’aube, les filtres industriels étaient marqués « Sphinx ». Les cigarettes du sphinx.
À l’autre extrémité de mon domaine de quatre règes, Sabrina, qui ignorait tout du film homonyme de Billy Wilder. Quel tempérament ! Pas une chatterie ne franchissait son barrage, un seul mot échangé prétextait qu’elle transformât « la belle Philippine », à deux rangées de là, en « pouffiasse qui suce les bites ». Philippine était le pôle d’attraction du carré de coupeurs, descendant d’Espagnoles, habillée pour offrir le bouquet au gagnant de Formule 1, une peau abricot. Les paniers qu’elle me tendait semblaient toujours plus jolis, mieux faits, mieux ornés que les autres. Chaque homme entrant dans la vigne filait droit sur elle qui, à moins de paraître impolie, n’achevait pas sa rège, le soin en restant à Sabrina furieuse, à Serge olympien, à Mikaël enfin. Mikaël était hydrocéphale, le crâne rasé fendu d’une cicatrice et recouvert d’un bob. Il parlait des kilos de cèpes qu’il ramassait en cette saison dans les bois avoisinants. Environ vingt fois par jour. Nous ne l’interrompions pas.
Le matin, vers neuf heures et demie, la rosée n’est pas déjà sèche, il manque ce café que la maison n’offre pas, Ignacio, depuis le tapis, envoie dans le frais un aria portugais, bientôt repris, sifflé en trilles, par l’ouvrier qui fourche dans la remorque, Mikaël égrène de longues chansons à textes qu’il connaît par cœur, Philippine fredonne à part elle des airs mélancoliques. À la pause de midi, Annabelle, une Gitane, est venue me trouver :
Tu sais pourquoi on dit « les vendanges de l’amour » ?
Non.
Parce que les gens copulent dans les allées.
Tous ensemble ? élude-je.
L’après-midi, Annabelle, encore elle, fait signer, à l’aide de feutres, une pensée à chacun sur le jean que tend son postérieur. Soudain, avant que quelqu’un ait pu l’en empêcher, elle se dirige vers Mouchta et les Marocains. Les Marocains ! Mouchta pose un genou en terre, en souriant se saisit de l’ourlet et écrit en petit, au-dessus du godillot, « Souvenir de Mouchta ». Le samedi soir arrive, suivi du dimanche qui coupera la vendange en deux. Où vont les filles ? Renseignements pris, au casino de Soulac. Elles claqueront vingt euros (petite soirée), trente, quarante (la fête). Sabrina, elle, se rendra au loto de Saint-Trélody, ça apprend à compter à ses deux drôles (jeunes garçons) qui rampent sous les tables en criant « Quïnte ! Quïnte ! » Parfois, des pauses montrent, en bout de rège, un groupe de vendangeurs alanguis, un coude sur l’herbe, à l’ombre des hottes. Sur la route qui traverse le paysage, devant, certains véhicules ralentissent, klaxonnent. Des conducteurs font des signes, auxquels nous répondons par des mouvements de bras. L’an prochain, avec de la chance, c’est nous qui aurons, de l’autre côté du pare-brise, un sourire réjoui.
Déjà, les ordres éclatent, on se relève en s’étirant. À l’exception de ces pauses, nous n’avons pas tenu compte du conseil de ralentir la cadence, descendu depuis la diligence, elle-même infiltrée par les ouvriers du domaine, noyautés par la direction. Nous avons littéralement notre rang à tenir. Serge, Sabrina, Mikaël et même Philippine placent une royauté dans le fait d’arriver premiers, rebelles à tout, serait-ce à l’ordre de moins travailler. La crainte, pourtant, d’écourter notre travail et de diminuer notre salaire nous tenaille le ventre. Le contrat donnerait lieu à des discussions avec la direction, ce qui, d’expérience, ne tourne pas souvent à notre avantage.
Notre efficacité ne crée pas la moindre mansuétude. Le patron, et s’il n’est pas là, le contremaître, continuent d’aboyer, nous traitent de fainéants. Une après-midi de pluie, avisant un porteur dont la hotte n’était pas remplie à son goût, le propriétaire y fit transvaser les paniers de tous les coupeurs disponibles, lesquels s’empressèrent, avec une joie maligne, d’en rajouter. Le pauvre bougre s’ébranlait dans l’allée boueuse, se retenant de carasson en carasson, quand le propriétaire l’arrêta, sa charge sur le dos, le temps d’ajouter à son sommet une grappe de raisin décorative. Lorsqu’il fut seul, j’allai trouver le propriétaire. « Quelle humiliation ! » dis-je. « Je suis heureux de ne pas en avoir infligé de pareille dans ma vie. Je ne voudrais pas être à votre place. » Il me fit répéter, et s’excusa immédiatement. C’était moi, le porteur.
Sixième jour. Septième. Le huitième, au matin, des bruits couraient, la vendange serait achevée ce soir, il y eut un éclat de trompe, près de la diligence. On y distribuait enfin des chocolatines (petits pains au chocolat), du café. Mais à peine eûmes-nous une minute pour nous y brûler, les ordres volaient à nouveau, plus rauques, plus enragés, disloquant les équipes, affolant la manœuvre. Une secrétaire parut, debout sur le capot d’une voiture, « Ceux qui veulent un chèque sans nom. Un chèque au nom. Ceux qui veulent un acompte, un virement… » La rumeur montait de coupeur en coupeur, dans un bruissement de feuillage, « le repas au château… » Les mieux informés tenaient qu’il aurait lieu sous les arbres du parc. On vit surgir la tête de Claude, hilare, il venait d’apprendre qu’il y aurait, d’abord, un apéro. En passant sous la diligence, afin de restituer les hottes, les sécateurs, les ouvriers permanents du domaine nous criaient, « Ça va être la fête, hein ? », « Bonne fête ! »
J’en frissonne rétrospectivement. Ce furent des claquements de portières, aux quatre coins de la vigne, chacun rentrait chez soi, d’ultimes mains se serraient, « On se revoit à la paye ? » Au bout de dix minutes, la croupe fut aussi déserte que s’il n’y était venu personne.
Nous touchâmes 640 euros, et la prime de ténacité.
J’ai rencontré Claude, en ville, qui m’a présenté Enzo, son fils de deux ans. Annabelle, devant moi au Crédit Agricole, a embrouillé et extorqué le banquier d’extraordinaire façon clin d’œil au passage, en remontant la file. Mouchta, lorsque nous nous croisons, prodigue des conseils coraniques. J’ai aperçu Sabrina au rayon charcuterie du supermarché, qui portait des savates, une robe de chambre, les cheveux mouillés et décolorés en attente de teinture. Serge, retrouvé hier matin à la Maison de la Presse, me dissuade d’intituler ce texte au nom du château, comme je l’avais initialement prévu, afin de léguer à son propriétaire, pendant trente ans, chaque fois qu’il consulte Internet, le sparadrap du capitaine Haddock. Il paraît que la récolte 2005 n’est pas si bonne.
L'Anachronique Conscience de classe
janvier 2006 | Le Matricule des Anges n°69
| par
Éric Holder
Conscience de classe
Par
Éric Holder
Le Matricule des Anges n°69
, janvier 2006.